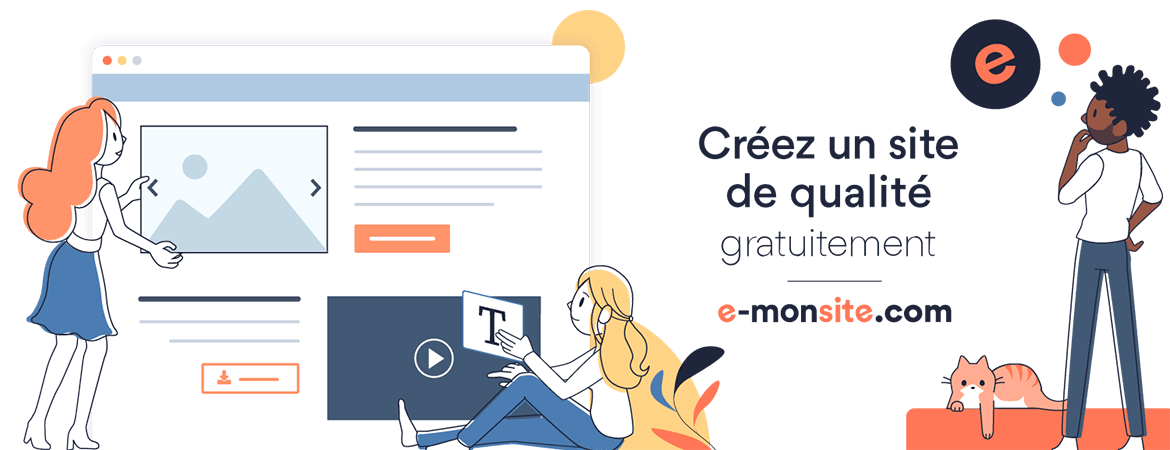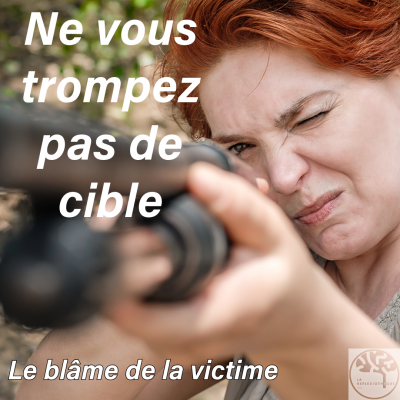Habitus clivé : s'inventer sans se trahir
- Par lareflexiothecaire
- Le 10/03/2025
- Dans CAPSULE DE REFLEXIO
- 2 commentaires
Lors d’une de nos conversations, ma grande sœur L. m’a posé une question qui m’a laissée songeuse : « Mais comment ça se fait que t’as toujours eu des copains qui avaient de l’argent ? ». Sur le coup, je n'ai rien su répondre, mais c'était une sacrée question.
Ma sœur venait de faire un infarctus à 50 ans. Elle aurait aimé se reposer sur les épaules de son compagnon après son opération, ce qui lui était impossible. Elle venait de souligner cette chance que j’avais de pouvoir rester au foyer pendant que mon mari subvenait aux besoins de notre famille.
Sa question est vraiment restée en suspens dans ma tête pendant plusieurs semaines. Elle avait clairement mis une pièce dans la machine. J’ai entamé l’écriture de cet article alors, il y a plusieurs mois. (Plus de 4000 mots, j’en conviens c’est énorme, mais il y a des gens qui en feraient un roman).
Je n'ai même pas eu le réflexe de corriger ce point : NON, je n’ai pas toujours eu des copains « riches ». Non, car j’ai eu des flirts avec des gens très différents. J’ai signé mon premier mariage avec un smicard (je le dis sans mépris) à qui j’ai chanté « Moi, je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc, les cages dorées. Toi, quand tu m’serres très fort, c’est comme un trésor, et ça, et ça vaut de l’or » le jour de nos noces. J’en ai toujours été convaincue, l’argent facilite la vie mais ne fait pas le ciment d’un couple.
Capital d’atomes crochus culturels
Non, il ne faut pas exagérer, je n’ai jamais eu de radar interne qui m’ait permis de repérer les corrélations entre les hommes et l’épaisseur de leur portefeuille. J’ai juste vécu quelques histoires inattendues. Mon premier amour, nous l’appellerons Paul, fils d’un très riche héritier et entrepreneur industriel. Une autre relation fulgurante et agitée avec un directeur financier d’un grand groupe. Mais même si occasionnellement, j’ai pu me retrouver dans une relation avec une différence de classe sociale notable, j’ai surtout observé que je partageais avec la majorité des hommes qui m’ont plu un territoire commun, au niveau intellectuel. Ce qu’on appelle le capital culturel.
Le capital culturel, c’est en gros tout ce qu’on accumule en termes de savoirs, de références et de manières de faire, qui influence la façon dont on se situe dans le monde. Ce capital se transmet le plus souvent par la famille et l’éducation et il existe sous trois formes :
- L’incorporé : c’est ce qu’on porte en nous, sans même y penser. Notre façon de parler, nos goûts, notre aisance à discuter de certains sujets plutôt que d’autres. C’est ce qui fait qu’on capte ou non les subtilités d’un livre, d’un film ou d’une conversation.
- L’objectivé : c’est ce qu’on possède concrètement/physiquement, comme une bibliothèque bien garnie, des tableaux accrochés aux murs ou même un piano qui traîne dans un coin du salon.
- L’institutionnalisé : c’est le capital validé par un diplôme, celui qui sert de passeport dans certains milieux et qui peut rassurer socialement : « Ah, t’as un Bac+5, t’es quelqu’un de sérieux ».
Ce capital culturel polymorphe façonne énormément les trajectoires et les interactions. Il ne garantit pas forcément la réussite, mais il donne certaines clés, notamment pour se sentir à l’aise dans des cercles où les codes culturels comptent autant que les compétences elles-mêmes.
La mutation de mon capital culturel
Qu’on pave mon propos tout de suite : je ne pense pas que l’intelligence ou la culture soient l’apanage des classes supérieures. J’ai croisé des gens brillants issus de milieux modestes et des types diplômés sans la moindre once de réflexion personnelle. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que certains codes culturels comme la lecture, l’aisance verbale, le goût de la discussion, la culture générale (tout ce que j’aime) sont plus courants dans certains milieux. Ça ne veut pas dire qu’ils y sont présents exclusivement, juste qu’ils y sont plus spontanément encouragés.
Là d’où je viens, le capital culturel n’était pas valorisé : pas de bibliothèque, d'ailleurs, quasiment pas de livres à part les classiques achats obligatoires étudiés au collège par ma sœur avant moi, ils sont inaccessibles à ma main, il me faudrait une échelle pour les atteindre. Pas de sortie culturelle, peu de discussions sur l’art ou la politique et peu d’encouragements à la curiosité intellectuelle. Mon père feuillette « Auto plus », ma mère « Femme actuelle » et le seul hebdomadaire trainant dans le salon c’est « Télépoche » que, paradoxalement, je lis avec application chaque semaine, tout comme l’énorme dictionnaire, offert par mémé, jusqu’à la lettre O. Vers mes 14 ans, je commence un carnet de mots où je répertorie les mots atypiques dont j'aime la sonorité et je deviens passionnée du dictionnaire des synonymes.
Autre anecdote, je me souviendrai toujours de ma nièce de 6 ans, interrogeant ma mère dans la cuisine sur ce qu’il se passe après la mort. Ma mère s'est tournée vers elle avec un quignon de pain qu’elle lui enfonça dans la bouche. Grosse prise de conscience intérieure : les questions s'étouffent avec du pain ici et il est fort possible que j’aie eu droit à ce type de traitement. Cela donne une idée du niveau de dialogue possible dans cette maison et de l’origine de mes troubles alimentaires.
Chez mes parents, la pensée était dénigrée et la valorisation de l’effort attachée uniquement au sport ou aux  travaux manuels. J’aurais été félicitée pour une victoire à un cross alors que mes bonnes notes ne m’ont jamais valu quelque compliment que ce soit. Il s'agissait d'obéir pas de réflechir. Il s'agissait d'agir, pas de deposer des questions.
travaux manuels. J’aurais été félicitée pour une victoire à un cross alors que mes bonnes notes ne m’ont jamais valu quelque compliment que ce soit. Il s'agissait d'obéir pas de réflechir. Il s'agissait d'agir, pas de deposer des questions.
Petite élève modèle sans réel besoin de travailler dur, j’ai fini de lever le pied en 4e, car il m’était répété qu’en raison de l’échec de ma sœur à la fac, moi, je n’irai pas. J’ai, malgré ça, de manière poussive, passé les classes jusqu’au bac, toujours un peu limite car très absorbée psychologiquement (toxicité familiale à son paroxysme pendant le lycée. J'en parle dans cet article). Ce parcours scolaire chaotique m’a conduit en section littéraire et m’a amené tranquillement à m’intéresser à des choses qui m'ont profondément nourrie. J'ai alors rencontré des amis très différents qui m'ont comme "sortie" de mon milieu d’origine.
Lorsque je rentrais à la maison, je cherchais ma respiration. J’ai commencé à bricoler mon identité personnelle avec ce désir profond de me différencier de ma famille, de leur vulgarité, leur vie de malheur, leur violence et de leurs préoccupations.
Le dessin dans un premier temps. Des heures à gribouiller, des BD entières qui racontent des fantasmes de vie d’après. Sans eux. Loin. Puis l’écriture et la lecture, comme échappatoires. Les journaux intimes bizarres d’une fille qui a peur d’être lue. Raconter les disputes avec intro, grand A petit b et conclusion sur les issues possibles. Intellectualiser sur leurs travers et le mal qu’on me faisait, pour ne pas trop ressentir, pour mettre à distance. Dresser des portraits psychologiques sans avoir vraiment les mots pour.
J’ai vite trouvé des modèles ailleurs à observer, les papas des copines, leurs mamans. J’étais comme une petite espionne, j’observais et j’analysais tout et je me dessinais de l’intérieur en imaginant que j’aurai une vie totalement différente une fois partie. J’étais habitée par un genre de rébellion intellectuelle, une volonté solide d’être différente d’eux. Ma sœur me l’a souvent dit, elle avait l’impression que je voulais toujours me démarquer. Elle avait raison. Je comprends que ça devait être dur à observer.
Tout y est passé, je me suis détachée de tout, je me suis même un peu opposée ce qui m'a valu encore plus d'agressivité de la part de mon père. J’ai cherché mes propres références, mon propre style vestimentaire, ma propre musique et à aimer des choses auxquelles ils ne s’intéresseraient jamais. La lecture, la culture, la philosophie, les spectacles, puis la psychologie (chez moi, celui qui consulte est fou), la sociologie etc. Je me suis forgée une petite culture, que je trouve un peu trop spécialisée et à la fois complètement éparpillée, assez étrange car née de la curiosité, de l’étude et aussi d’une part d’imitation. Contrairement à un bourgeois qui grandit dans le capital culturel, moi, j’ai appris, étudié, observé, imité pour m’y glisser. Ce n’était pas acquis, mais plutôt le fruit d’une observation attentive, d’une volonté de m’élever ailleurs que là où j’avais été plantée à la naissance.
La distinction
Si le capital culturel était peu présent dans mon milieu d’origine, il y avait pourtant, chez mes parents, une volonté de distinction. La distinction, au sens de Bourdieu, désigne la manière dont les individus cherchent à se différencier socialement à travers leurs goûts, leurs pratiques culturelles et leur style de vie.
Mon père et ma mère étaient, j'ai l'impression, des gens particuliers. Il suffisait d’observer leur maison au milieu du reste du lotissement : des bâtisses tristes et mitoyennes, toutes identiques, construites en série, avec le strict minimum. Leur maison et le jardin, à eux, sortaient totalement du lot, clôturée proprement, l’ouvrage maçonné peint en blanc immaculé. Maison bien équipée, régulièrement redécorée et mise au goût du jour. Les extérieurs donnaient l’impression d’avoir été dessinés par un paysagiste. Mon père passait des heures sur l’ornement des plates-bandes. Il y avait un espace dit "rocaille", très organisé. Il avait une obsession pour certains arbustes et un talent pour l’harmonie végétale. Je ne sais pas d'où lui est venu ce talent pour les jardins.
Ils avaient tous deux le goût pour les belles choses, accordaient de l’importance à l’apparence. Ma mère avait un talent indéniable pour la couture qui nous valait d’être toujours bien habillés et d’avoir les plus jolis déguisements pour Mardi gras. C’était une belle femme, racée, très maniérée mais gracieuse, même lorsqu’elle a perdu le contrôle de son poids. Toujours apprêtée, aujourd’hui encore à 72 ans, elle semble perpétuellement en représentation.
Plusieurs de leurs pratiques sociales reflétaient une aspiration à se démarquer. Mon père, dans les années 80, a commencé le running, ça n’avait pas du tout la même image et popularité qu’aujourd’hui. C’était un sport individuel, de cadre, pratiqué par les CSP+, pas un hobby d’ouvrier. Le culte du corps historiquement, s’inscrit plutôt dans les classes moyennes supérieures. En milieu ouvrier, le corps est plutôt un outil de travail, fonctionnel. Mais mon père avait cette préoccupation pour le corps, pour la santé, pour l’hygiène.
Ma mère était aide-soignante. Sa propre mère, issue d’un milieu plutôt paysan, était, elle aussi, devenue aide-soignante à l’hôpital. Une femme vraiment spéciale ma grand-mère… Lorsque j’y repense, l’outsider de la lignée, la première à se sortir des champs. Elle m’a beaucoup accompagnée pendant sa vie, j’ai passé énormément de temps chez elle, c’était une femme vraiment atypique. Le métier d’aide-soignante requiert de nombreuses compétences (techniques, relationnelles, organisationnelles). Ma mère a exercé cette profession avec talent et d’autres professions où elle a su montrer qu’elle était capable de plus que ce qu’on attendait d’elle. Elle se voyait confier des reponsabilités rapidement. Est-ce qu’on peut voir, derrière tout ça, une volonté de se distinguer ? Sans doute.
Leur quête de distinction, bien que différente de la mienne, reste très certainement comme un héritage en moi, une empreinte qui, à sa manière, a façonné mon regard sur le monde et mon parcours. Cette recherche de distinction c’est le terreau de mon histoire ; finalement, j’ai peut-être suivi le chemin qu’ils m’ont enseigné bien plus que je ne le pense.
Conscience de classe et légitimité
C’est en Terminale que j’ai commencé à m’éveiller à la conscience de classe. J’aurais été bien incapable d’utiliser ce terme à l’époque. Mais si j’y réfléchis c’est bien ça : la conscience de classe, c’est la prise de conscience qu’un individu ou un groupe social a de sa position dans la hiérarchie sociale, de ses intérêts communs et des rapports de domination entre les classes.
Au travers de mes amitiés puis de mon histoire d’amour avec Paul, j’ai commencé à prendre conscience des différences sociales et culturelles. En terminale, certaines de mes amies se faisaient offrir des livres très chers, en plus de ceux demandés par les profs. Elles allaient au CDI pour « passer le temps » au lieu de fumer des cigarettes dehors. Je me souviens particulièrement de Delphine, longiligne, brillante, d’une légèreté incroyable lorsqu’elle parlait de ses lectures et était capable de citer des auteurs. Je me suis engagée politiquement, j’ai commencé à avoir des débats incroyables avec des copains d’une très grande maturité, qui avaient tout ce temps pour réfléchir au monde, alors que je semblais juste préoccupée par ma survie. J’ai été très bonne élève en philo, complice avec mon professeur qui me promettait un avenir radieux, rapidement gâté par les limites qu’allaient ériger mon père. Avec eux, c'était un autre monde qui s'ouvrait, d'autres possibles et rien chez moi, dans mes questionements, ne leur semblait futile ou stupide.
J’ai quitté le domicile familial après le bac – contre la volonté de mes parents – et j’ai été accueillie comme jeune fille au pair chez Paul. Sa mère était artiste peintre et son père, donc, un très riche entrepreneur dans l’industrie. Là, j’ai découvert un univers où l’on goûtait de grands vins en discutant d’art et de politique alors que le petit dernier nous offrait un récital de Bach sur le piano du salon. Le capital culturel, tous les soirs à table, étalé sur des tartines de pain aux noix.
Je me régalais de tout ça. Mais malgré tous mes efforts, les années passées à me cultiver, il me manquait clairement quelque chose. Une base de culture générale indéniablement, mais surtout une capacité à bavarder, je dirais. Une aisance à manier des références culturelles, parfois de manière superficielle, mais qui donne une impression de maîtrise et d’évidence. Ce n’est pas tant la connaissance réelle qui importe que la manière d’en parler, avec désinvolture, comme si tout cela allait de soi.
Pour quelqu’un qui, comme moi, venait d’un milieu où la culture n’est ni un sujet de conversation, ni un capital transmis, cela peut être extrêmement déstabilisant. J’ai eu l’impression d’être toujours en décalage, de ne pas savoir quoi dire et surtout de manquer de légitimité pour entrer dans les échanges. Il a suffi de quelques moments difficiles, qu’on pourrait parfaitement appeler de la violence symbolique, pour que j’intègre que là non plus, je ne serai jamais à ma place. Quelques railleries sur des expressions populaires qui sortaient de ma bouche. Le mal de mer lors de la balade en voilier : « Tu n’es pas habituée ». Ce jour où la mère de Paul m’a demandé de porter un tablier de soubrette pour faire le service lors de son goûter d’artistes dans le jardin.
Cette question de la légitimité et le syndrome de l’imposteur qui va avec me bloquent encore aujourd’hui dans ma communication. Malgré l’assurance que je pourrais avoir développée sur mes connaissances ou capacités, je suis bien souvent incapable de les restituer (à l’écrit, un peu mieux). Entourée de personnes manifestement élevées dans la culture légitime, je me vois comme une attraction, une bizzarerie qui ferait bien de ne pas trop s'étaler. Je suis toujours un peu décalée.
J'ai réalisé une chose : le capital culturel ne fonctionne pas comme une richesse absolue, mais comme une monnaie qui n’a cours qu’entre ceux qui la possèdent déjà. Lire, accumuler du savoir, élargir son vocabulaire n’a aucune valeur sociale en soi tant que ce n’est pas reconnu par un pair. C’est un jeu circulaire : seuls ceux qui détiennent ce capital sont en mesure de consacrer celui des autres. Dans un milieu où personne ne partage ces codes -ma famille-, il ne vaut rien, voire il devient suspect. L’autodidacte se heurte ainsi à une barrière invisible : tant qu’il ne parvient pas à faire valider son capital culturel dans les espaces légitimes (université, réseaux intellectuels, professions reconnues), il reste intangible, comme une monnaie sans banque centrale. Donc, dans cette famille d'adoption, il me fallait sans cesse me faire valider et dans mon milieu d'origine, j'allais être rejetée.
Pour ma famille, ces connaissances ou capacités (mon écoute, ma psychologie, mon niveau d'expression, mes qualités rédactionnelles...) sont tantôt réclamées , tantôt très mal accueillies. Malgré toute mon application à parfois gommer ma personnalité, j'ai l'impression d'être un traître, je suis toujours à marcher sur des oeufs, tiraillée entre ce que j'ai le droit ou pas, de dire et d'être. Un jour, on fait appel à moi parce que "toi tu t'y connais" et le lendemain je ferais mieux de "ne pas me prendre pour un puits de sciences".
***
Cette année passée chez Paul m’a permis de poursuivre mes études grâce à l’aide de son père. Il s’est porté caution pour mon prêt étudiant. En parallèle, j’ai accepté de renoncer à une bourse pour que mes parents perçoivent toujours les allocations et me versent une petite somme chaque mois.
C’est en intégrant l’IUT que j’ai réellement mesuré l’ampleur des écarts de classe. Là où, pour certains, faire des études était simple, pour moi, cela relevait d’un combat : job en restauration, missions d’hôtesse, aucune vacances scolaires car consacrées à travailler pour gagner de l’argent, absence de matériel informatique donc obligation d’aller à la BU pour taper mes devoirs hors cours, pas de tata qui trouve un stage dans un grand groupe, pas de carnet d’adresses… en gros, pas de capital social. En communication, ceux qui s'en sortaient, c'étaient ceux qui avaient des relations.
Mon parcours universitaire a été marqué par cette double conscience : l’opportunité d’un accès à la culture et l’éducation, mais aussi la difficulté d’y trouver pleinement ma place. Pourquoi ? Parce que ça m’a semblé plus dur, moins accessible. Je devais faire beaucoup plus d’efforts, à tous les niveaux. Et certains weekends, alors que je venais chez Paul, je rencontrais ses amis étudiants aux Beaux-Arts, qui vivaient dans des appartements haussmanniens, dont l’un avait été décoré par le designer Philippe Starck.
Question de transfuge ou d'habitus ?
En cherchant à analyser tout ça, il y a quelques années j’étais tombée sur le concept de transfuge de classe. Il y a bien eu la mère de Paul qui m’avait offert « La Place » d’Annie Ernaux en 97. Je ne me souviens pas d’une lecture transcendante. Plus tard, j’ai lu Eribon. Plus j’avançais dans la compréhension du concept, moins cela semblait me correspondre. Oui, dans mon milieu d’origine, je sentais bien un décalage. Ce décalage a été à l’origine de tous les petis conflits avec ma famille ces dernières années. J’ai été renvoyée dans mes filets, un jour accusée d’utiliser « trop d’adverbes », de me « la raconter », de « me prendre la tête » alors que j’ai vraiment la sensation de n’être rien d’autre que moi-même et surtout, discrète, pas dans l’étalage. Et puis, au final, pourquoi ils me rejettaient ? Pour mon phrasé et quelques références culturelles ? Moi, quand je nous regardais tous, socialement, financièrement, j’étais toujours dans le même bain. C'était le capital culturel qui était de trop entre nous.
En effet, si j’ai acquis une forme de capital culturel qui me distingue de mon milieu d’origine, mon capital économique, lui, n’a pas suivi cette trajectoire. Malgré mes études (bac+2 puis 3), le manque de contacts dans le milieu et l’obligation d’arrêter les frais (première échéance de prêt à rembourser dès septembre), m’ont rapidement plongé dans le marché du travail alimentaire. Pas d’opportunités, pas de contacts, des missions CDD à la chaîne ; une déqualification progressive assortie de vraies tartes dans la tronche m’ont éloigné peu à peu du fantasme de la réussite professionnelle et de l’aisance financière. Aujourd’hui, je ne travaille même plus. Mon parcours ne correspond donc pas à l’idée d’un transfuge de classe au sens classique du terme, où l’émancipation passe généralement par une réussite professionnelle et économique marquée.
J’ai rencontré ensuite un autre concept, ce que Bourdieu appelle l’habitus. Il le définit ainsi : l’habitus est un ensemble de dispositions acquises dès l’enfance, qui influencent nos goûts, nos comportements et notre perception du monde. Selon lui, notre environnement social nous modèle : nos préférences alimentaires, musicales, nos façons de nous exprimer sont le reflet de notre classe sociale d’origine.
Comme je l’expliquais plus haut, j’ai exprimé assez tôt un rejet de l’habitus familial. Cette construction en opposition m’a valu de m’intéresser à des choses dont on ne parlait pas chez moi. En m’ouvrant, en découvrant et avec ce goût d’apprendre, j’ai rencontré des personnes d’origines sociales différentes. Elle est là la réponse à la question de ma sœur finalement.
Avec la construction de ce bagage d’apprentissage indépendant, de ce capital culturel, j’ai été amenée à rencontrer des hommes qui possédaient eux aussi un bagage, du capital culturel qui s’assortissait parfois d’un capital économique. Certaines classes sociales cumulant les capitaux.
Parce qu’en vrai, moi, je ne suis pas différente des autres, au début je tombe amoureuse pour de stupides raisons : un regard, un geste, une façon d’être à la vie. Mais je l’ai remarqué plus tard, je tombe vraiment amoureuse d’hommes intelligents, ou en tout cas, ceux qui le paraissent. Je suis touchée par un phrasé, un vocabulaire, une certaine culture et par la sensibilité. Je suis transportée par la finesse d’esprit et l’humour bien dosé. J’ai eu beau essayé de m’intéresser à d’autres types d’hommes, ce sont les cerveaux bien faits qui m’attirent le plus.
Et ces caractéristiques, ce vocabulaire que j’aime, cette capacité à discuter, à se remettre en question, à dialoguer, à évoluer, à refaire le monde, je les ai par exemple trouvés chez mon mari. Il est l’exemple parfait de l’homme au capital culturel prégnant. Il possède une culture générale solide, une mémoire riche, il est ouvert, se montre toujours réceptif à la discussion et je m’autorise peut-être avec lui seul à « bavarder » de mes connaissances sans me sentir complexée. ll joue un rôle de légitimation, non pas parce qu’il m’« apprend », mais parce qu’il reconnaît et met en valeur ce que je sais. Il me crédite régulièrement de la validité de mes connaissances, il les cite, il s’en sert, il les incorpore à ses propres connaissances et par ce geste il leur donne une existence sociale. À travers lui, mon capital culturel cesse d’être clandestin : il devient visible, utilisable, reconnu.
Il est issu de la classe bourgeoise et évidemment cela a un impact sur notre vie. Nous avons accédé à un certain niveau de confort. Nous vivons dans une maison qui m’aurait fait rêver étant enfant, mais que je n’aurais jamais imaginé habiter. Nous n'avons pas exactement une vie bourgeoise, dans le sens où nous vivons assez simplement, nous n'avons pas de coups de folie ni d'extravagance. Pas de rêve de SUV ni de voyages exotiques. Ce qui fait la différence, c’est que ses dividendes réguliers nous permettent d’avoir un certain confort ou plutôt, de nous éviter les inconforts (comme faire des crédits, attendre quand on a besoin de quelque chose, ou faire des choses compliquées qui sont plus simples avec de l'argent). Bien que son salaire soit confortable, il ne suffirait pas à maintenir le niveau de vie que nous avons aujourd’hui. Pour tous les travaux, dépenses imprévues, on a cette épargne. C’est ça qui distingue le milieu bourgeois, c’est que les richesses acquises ou héritées agissent comme des ressources supplémentaires qui assurent une stabilité et facilitent le quotidien.
Malgré cela, je ne suis pas un transfuge de classe, l’argent et le milieu ne suffisent pas à faire de moi une bourgeoise : ma manière d’être (ma façon de dépenser, ma façon d’éduquer par exemple…), mes réflexes et certaines de mes références restent ancrés ailleurs.
L'habitus clivé
En miroir de l’habitus, Bourdieu parle d’habitus clivé pour décrire la tension interne ressentie par des individus dont le parcours de vie a traversé plusieurs milieux sociaux. Lorsqu’une personne connait une mobilité sociale significative (comme passer d’un milieu populaire à un milieu bourgeois), elles développent un habitus clivé : elles portent en elles deux ensembles de dispositions parfois contradictoires, ce qui crée un tiraillement entre leur identité d’origine et leur nouvel environnement.
Pourquoi mon habitus à moi serait-il clivé ? Parce que j’ai le sentiment que tout ce modelage que j’ai internalisé dans mon enfance a subi des mutations. Mon habitus d’origine, même si je lui ai tourné le dos avec énergie, j’y ai encore un pied. Mon habitus d’adoption, celui que j’ai façonné dès l’adolescence, j’y ai l’autre pied. C’est précisément dans cet inconfort que je ressens en permanence où que je sois, que je me sens écartelée. J’erre ainsi entre deux mondes.
Je note bien que dès l’enfance, un décalage se creuse. Mon intérêt pour la lecture, la réflexion et la culture me place à la lisière de ma propre maison, où je suis de plus en plus une étrangère. Et pourtant, cet ancrage initial ne disparaît jamais vraiment, il persiste en moi, créant une tension permanente entre deux univers, entre ce que j’ai été et ce que je suis devenue. C’est peut-être cela, au fond, l’habitus clivé : une errance identitaire entre deux mondes, sans jamais se sentir totalement à sa place ni dans l’un, ni dans l’autre.
Cela pourrait être très intéressant de réfléchir à la manière dont certains comportements sont durablement marqués par les origines sociales, même après des années de tentatives d'intégration dans des milieux plus « intellectuels ». Prenons deux exemples.
- Ma gestion des conflits. Il arrive que dans certaines situations, je sois quelqu'un de frontal, c'est quasi instinctif.
Je ne suis pas colérique, mais je suis frontale. J'insiste sur la nuance. Dans les conflits, je conserve la frontalité directe héritée de mon milieu d’origine : dire les choses sans détour, entrer dans l’affrontement, pas forcément avec agressivité mais avec fermeté. Ce mode de gestion, qui tranche avec les codes plus feutrés et stratégiques des classes cultivées, me trahit parfois malgré mon vocabulaire ou mes références.
- Mes difficultés avec l’alimentation s’inscrivent dans une logique de gestion des émotions apprise dans un milieu où l’expression de la souffrance se faisait rarement par des mots, mais souvent par des gestes plus discrets, comme le recours à la nourriture. Si j’ai pu un temps lutter contre cette tendance, l’alimentation reste pour moi une zone de confort, un refuge face à des émotions parfois trop vives.
Ainsi, ces deux exemples – la gestion des conflits et l’alimentation – montrent à quel point certaines stratégies d’adaptation, liées à des vécus familiaux et sociaux, continuent d’influencer ma manière de vivre, malgré la distance sociale et culturelle que j’ai pu prendre. Ce double ancrage, entre volonté d’évolution et poids du passé, est l’un des éléments centraux de ma réflexion.
Je termine sur ce dernier point, majeur : un trait caractéristique de l’habitus clivé, c’est l’hyper-conscience de sa position sociale. Je savais très tôt d’où je venais, où je me situais, et j’analysais sans cesse les écarts. Mon mari, lui, n’avait jamais eu à se poser ce type de question avant de me rencontrer : son habitus était aligné, naturel, allant de soi. Là où lui vivait son appartenance comme une évidence silencieuse, je vivais la mienne comme une tension permanente, une colère sociale silencieuse : pas dirigée contre quelqu’un en particulier, mais contre les structures, les codes implicites et les hiérarchies invisibles qui renvoient constamment à mon décalage.
Dans la famille de mon mari, certaines ressources financières existent presque naturellement : la propriété génère des revenus réguliers sans intervention directe, et ce capital économique se maintient indépendamment des actions individuelles.
De même, là où j’ai dû construire mon capital culturel par mes propres efforts, la lecture, l’observation et l’échange intellectuel, d’autres grandissent dans un environnement où ce capital est offert, valorisé et soutenu en permanence. Ce n’est pas simplement une question de connaissances : c’est la différence entre chercher à exister dans un monde culturel et y baigner dès la naissance.
***
Voilà. Tu vois, c’est tout ça L., qui a fait que j’ai rencontré des hommes « riches ». C’est parce que j’ai mis ma colère et mon rejet de notre enfance et de ce qu’on a vécu, dans le développement de quelque chose d’un peu flou, dans un positionnement intellectuel et dans ce capital culturel. J’avais des dispositions, peut-être (c'est flatteur d'y croire, j'avoue). Où ai-je trouvé cette envie, cette énergie, pourquoi je suis comme ça ? Je n’en sais rien… Ce qui me chagrine, c'est que je ne pourrais pas te faire lire cet article L. Je le sais. Je ne pourrais jamais te dire que j’ai la réponse parfaite à ta question. Tu pourrais penser que j’ai cette vie parce que je voulais juste "être mieux que les autres". Tu pourrais penser que je n'ai rien fait de spécial, que "j'ai de la chance" comme tu dis, que je rencontre des mecs cultivés et gentils parce que j'ai de la chance. Ce que j'ai écrit là, ce que je suis devenue, tout ça sonnerait étranger, inutile, ou prétentieux à tes yeux. Ça l’a toujours un peu été, non ? Ce n’est pourtant pas contre toi que je suis ce que je suis. C’est juste que nos chemins, façonnés par nos histoires et nos douleurs, ont pris des directions différentes. On a fait ce qu'on pouvait.
Regarde, aujourd’hui, je continue d’écrire, de réfléchir, de tracer des ponts entre les univers qui me composent. Car au fond, c'est peut-être ça, l’issue : ne pas choisir un camp, mais créer un territoire nouveau, à soi, où penser et exister ne sont plus des actes de trahison ou de rébellion, mais juste une façon d’être.
***
Un grand merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'au bout.
Extrait de la bande originale écoutée pour l'écriture : https://www.youtube.com/watch?v=Z4k5PjHomxc
chronique sociologie introspection
Commentaires
-

- 1. Anne Le 17/03/2025
Bonjour,
Votre intelligence et votre capital culturel vous ont donc permis de vous "élever". Et vous faites donc figure d'une outsider dans toutes les classes sociales car vous avez un profil potentiellement unique.
Habitus clivé, ce sentiment de vivre entre "deux monde", vous conservez par la colère les réflexes de votre milieu d'origine ? Mais pourtant vous n'avez pas changé de milieu sociale par vous même, je parle d'une ascension professionnelle. Vous ne mentionnez aucune chose à ce sujet, mis à part des problèmes relationnelles avec les autres qui ne vous comprennent pas. Vous avez donc eu accès à ce milieu "bourgeois" par votre mariage.
Le capital cultuel n'est pas le seul moyen de s'élever, le capital économique et social sont également important.
Les transfuges de classes sont rares, il faut des codes, des opportunités, un réseau. Peut on dire que le réseau de votre mari vous aide à prendre votre place dans ce milieu ?
J'essaie de comprendre. je ne mets aucunement en doute votre intelligence, vos articles en sont la preuve. Mais cet article m'a interpellé. Alors que les autres passés. Dans la distinction, les individus se différencie des autres classes par leur culture légitime. Est ce que vous vous distinguez de votre milieu par votre intelligence ? La seule possibilité est donc de vous retrouver avec des individus intelligents donc de la classe bourgeoise ? La classe moyenne et populaire ne peut pas égaler sur ce point ? est ce que comme vous êtes une femme dépendante des revenus de votre mari et que vous vous consacrez à l'éducation de votre enfant, l'entretien de la maison, la gestion au quotidien de la vie de famille, vous rentrez dans la classe bourgeoise comme le démontre le couple Pinçon-Charlot.
Est-ce une chance de s'élever que par le mariage ? que ferez vous si un jour tout s'arrête ?
ils n'y a pas d'attaque, juste votre article à soulevé des questions en moi. JE dois vous avouer que c'est très rare. Par avance, je suis navrée par avance pour les fautes même si je relis ma dyslexie et ma dysorthographie me joue des tours. Des raisons pour lesquelles je n'interagis que rarement à l'écrit.
Bon courage à vous et belle journée.
Anne-
- lareflexiothecaireLe 19/03/2025
Bonjour Anne, Merci pour votre message, il est rare d’avoir des retours aussi construits et argumentés, et j’apprécie que vous ayez pris le temps d’écrire malgré vos hésitations. Je suis heureuse que ce texte vous ait poussé à m'écrire. Mon article porte sur le capital culturel et sur la manière dont il m’a éloignée de mon milieu d’origine. Dès l’adolescence, mes centres d’intérêt (lecture, philosophie, psychologie, débat d’idées) m’ont poussée à rechercher des échanges intellectuels qui n’étaient pas possibles dans ma famille. Je ne choisissais pas mes interlocuteurs en fonction de leur classe sociale, mais en fonction de leur appétence pour ces sujets. Ce sont ces affinités qui, progressivement, m’ont mise en contact avec des personnes issues d’un autre milieu, sans que ce soit une démarche consciente ou volontaire de "m’élever". Vous soulevez la question de l’intelligence comme facteur de distinction. J'ai fait un petit paragraphe en italique dans l'article mais je vous le redis ici : "Je ne pense pas que l’intelligence ou la culture soient l’apanage des classes supérieures. (...) Ce qui est vrai, en revanche, c’est que certains codes culturels – la lecture, l’aisance verbale, le goût de la discussion et de la culture générale – sont plus couramment transmis et valorisés dans certains milieux. Cela ne signifie pas qu’ils en sont exclusifs, mais simplement qu’ils y sont plus spontanément encouragés." Concernant la question de la réussite sociale et de la mobilité ascendante, je ne me considère pas comme une transfuge de classe, je le dis. Je n’ai pas gravi les échelons professionnellement et mon mariage n’a pas été un levier d’ascension socio-professionelle (en tant que femme de militaire, j'oserais presque dire que les déménagements ont fini de l'achever ahah!), il fût plutôt une conséquence indirecte de mon parcours. Je n’ai ni capital économique ni réseau permettant une reproduction sociale, donc la définition "bourgeoise" des Pinçon-Charlot ne s’applique pas à moi. Enfin, je trouve intéressante la question de ma dépendance économique, comme si la finance était l’enjeu principal. Si je devais me séparer de mon mari, ma préoccupation ne serait pas le maintien de mon niveau de vie, mais la douleur de la perte. Je serais dévastée ... Notre relation est fondée sur l’amour et une grande complicité intellectuelle et c’est cela qui compte pour moi. Je préfère me projeter dans une vie heureuse plutôt que d’anticiper un scénario catastrophe envisagé par des tiers, d’autant que j’ai confiance en ma capacité à rebondir. En résumé, mon propos n’est pas celui de la réussite sociale par le mariage, mais de l’éloignement progressif de mon milieu d’origine par la construction de mon capital culturel et de mon évolution avec un habitus clivé. Merci encore pour votre message et au plaisir d’échanger ! Ps du lendemain : Le titre "habitus clivé " me semble plus adapté que transfuge, loin d’être une trahison de mon milieu d’origine, l’habitus clivé traduit plutôt une tension entre plusieurs appartenances, une cohabitation parfois inconfortable entre des univers sociaux et culturels différents. Mon propos n’est pas de dire que j’ai « réussi », mais de montrer comment mon capital culturel m’a progressivement éloignée de mon milieu sans pour autant m’ancrer pleinement dans un autre.
Ajouter un commentaire